Visits: 0
 Lorsqu’en 2011, la Cour Constitutionnelle prenait sa décision autorisant le retrait du droit de grève aux douaniers, peu de gens avaient bien lu l’intitulé de cette loi. Il s’agissait pourtant de la loi n° 2011-25 portant règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés en République du Bénin, votée par l’Assemblée Nationale, le 26 septembre 2011. En clair, la loi en question interdisait aux militaires aussi d’exercer le droit de grève. Et cela n’étonne personne, étant donné que c’est la pratique dans toutes les armées du monde. Or, la dernière décision de la Cour rend cette loi caduque en ce qu’elle annule l’une de ses dispositions les plus essentielles. Elle réhabilite le caractère absolu du droit de grève et donne aux militaires et aux paramilitaires le droit de grève, qui sous-tend aussi celui de se syndiquer. Alors question : La Cour veut-elle nous dire qu’au Bénin les militaires disposent du droit de grève, et donc celui de se mettre en syndicat ? Les syndicats des douanes et de la police sont désormais fondés à former un recours demandant à la Cour la conduite à tenir face à leur droit de grève, étant entendu que sur leur cas seul, la même juridiction a rendu deux décisions absolument contradictoires. Dans ce cas, qui risque d’arriver un de ces jours, que ferait la Cour prise au piège de ses propres contradictions ?
Lorsqu’en 2011, la Cour Constitutionnelle prenait sa décision autorisant le retrait du droit de grève aux douaniers, peu de gens avaient bien lu l’intitulé de cette loi. Il s’agissait pourtant de la loi n° 2011-25 portant règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés en République du Bénin, votée par l’Assemblée Nationale, le 26 septembre 2011. En clair, la loi en question interdisait aux militaires aussi d’exercer le droit de grève. Et cela n’étonne personne, étant donné que c’est la pratique dans toutes les armées du monde. Or, la dernière décision de la Cour rend cette loi caduque en ce qu’elle annule l’une de ses dispositions les plus essentielles. Elle réhabilite le caractère absolu du droit de grève et donne aux militaires et aux paramilitaires le droit de grève, qui sous-tend aussi celui de se syndiquer. Alors question : La Cour veut-elle nous dire qu’au Bénin les militaires disposent du droit de grève, et donc celui de se mettre en syndicat ? Les syndicats des douanes et de la police sont désormais fondés à former un recours demandant à la Cour la conduite à tenir face à leur droit de grève, étant entendu que sur leur cas seul, la même juridiction a rendu deux décisions absolument contradictoires. Dans ce cas, qui risque d’arriver un de ces jours, que ferait la Cour prise au piège de ses propres contradictions ?
Ce qui est encore plus incroyable, c’est la composition de la Cour au moment où elle prenait les deux décisions querellées. En 2011, ils étaient six membres, Robert Dossou n’en étant pas signataire. Sur les six qui avaient pris la décision, quatre (soit plus de 66%) sont encore membres de la mandature actuelle, y compris Théodore Holo, le Président. On assiste à un paradoxe insurmontable : presque les mêmes individus se rassemblent pour prendre sur le même objet deux décisions inconciliables.
Cette décision oblige à actualiser au moins deux lois déjà déclarées conformes à la constitution : la loi n° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin qui a prévu en son article 2 les « agents à qui la loi interdit expressément l’exercice du droit de grève » ; et la loi n° 2011-25 portant règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés dont l’article 9 indique clairement qu’ils « sont tenus d’assurer leur mission en toute circonstance et ne peuvent exercer le droit de grève ». Il en est de même de la loi portant statut des personnels de la Police républicaine votée le 28 décembre. Elle dispose en son article 71 : « Les fonctionnaires de la Police républicaine sont tenus d’assurer leurs missions en toutes circonstances et ne peuvent exercer le droit de grève ».
Tôt ou tard, le parlement sera contraint de revenir sur ces dispositions, non pas à cause de sa méconnaissance de la constitution, mais du fait de l’insécurité juridique dans laquelle la haute juridiction s’est installée. On pourrait au surplus consulter la décision DCC-15 du 16 juillet 2015, par laquelle la Cour (la même qu’aujourd’hui) faisait une démonstration ubuesque tendant à faire croire que 39 ans + 1 seconde équivalent à 40 ans.
La décision du 18 janvier est ainsi similaire à celle du 16 juillet 2015. Elle est politique, purement et simplement. Mais alors quelles pourraient être les motivations politiques qui la sous-tendent ?
Premièrement, régler leur compte au parlement et au gouvernement en montrant aux deux la primauté de la Cour. Cette volonté est peut-être légitimée par la récente crise née de l’impossibilité pour le parlement de respecter l’injonction faite par la Cour en vue d’installer les membres du COS-LEPI. Deuxièmement, il y a peut-être une volonté de concourir à la paix sociale, étant entendu que la levée de bouclier générale observée, la semaine dernière, pouvait déboucher sur une situation intenable. Mais là, il s’agirait d’un faux calcul puisque les centrales ont reconduit leur mouvement, malgré la décision de la Cour.
De tout cela, nous pouvons retenir que la Cour s’est une fois de plus fourvoyée en prenant une décision qui constitue un recul dangereux dans la construction d’une démocratie responsable. Désormais, dans le monde, on retiendra que le Bénin est le pays où les militaires disposent du droit de grève. C’est une aberration dont on devrait faire l’économie.
Par Olivier ALLOCHEME


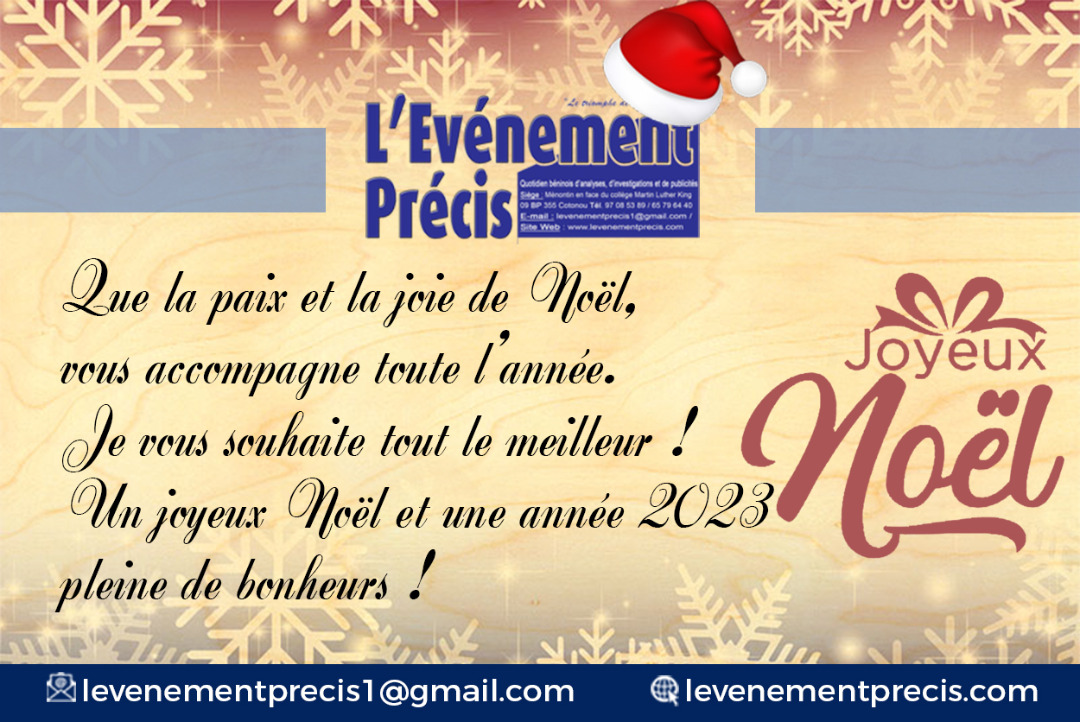
Moi je dois faire observer que le juge ne fait par recours à une jurisprudence que lorsqu’il n’a pas d’éléments juridiques indispensables pour apprécier un dossier soumis à son examen. Donc, dans le cas d’espèces le juge constitutionnel n’est pas obligé de suivre la jurisprudence précédente. Par ailleurs le juge constitutionnel a été saisi spécifiquement pour le cas des magistrats et agents de justice et de santé. J’ai l’impression que c’est à dessein que les ” dépités” et non députés ont associé le cas des militaires au cas querellé .Donc, trêve d’intoxication et d’interprétation tendancieuse de la décision de la cour. MERCI